|
Moyen-Age (2)
|
|
|
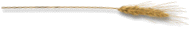 |
Alors qu'à la campagne on continue à brasser dans le cadre
familial, dans les villes la brasserie devient une activité artisanale
et masculine.
Parmi d'autres privilèges, dans certaines villes, les évêques possédaient
le «droit de Gruyt», droit sur le mélange des plantes aromatiques
servant pour la bière. C'était un monopole et un secret jalousement gardé.
Les brasseurs pouvaient fabriquer la bière sans problème, mais ils devaient
acheter au moulin une certaine quantité de «gruyt» par sac de malt. On
savait que la coriandre, le romarin, le genévrier le composaient, mais
les proportions restaient secrètes. Dès 974, l'empereur Otton II, empereur
germanique, accorde ce privilège à l'évêque de Liège. On en fait mention
pluiseurs fois au cours des siècles suivant et, en 1461, les brasseurs
de Cologne en Allemange rachètent ce droit à leur évêque vraisemblablement
pour le remplacer par le houblon. Perdant ainsi leur monopole,.plusieurs
évêques protestèrent avec véhémence contre l'introduction de cette nouvelle
plante qui se substitue définitivement au «gruyt».
| C'est en 1259 qu'apparaît le premier brasseur de
métier à Strasbourg. Ensuite les brasseries artisanales ne vont
cesser de se développer en France et en Europe, ce qui va détruire
petit à petit les brasseries monacales qui ne pourront faire face
à la concurrence, d'autant plus que l'église va favoriser de plus
en plus la culture des vignes et la consommation de vin au détriment
de la bière. Du fait du développement massif des brasseries artisanales
dans un grand nombre de villes françaises, l'autorité publique soucieuse
de protéger la santé du consommateur décide de réglementer la composition
de cette boisson et donc de limiter l'ajout d'aromates comme par exemple
la cannelle, le safran, les clous de girofle… |
 |
Les brasseurs vont donc organiser leur métier en formant des corporations
et à partir de cette époque, seuls les brasseurs auront le droit de vente
exclusif de la bière.
|
